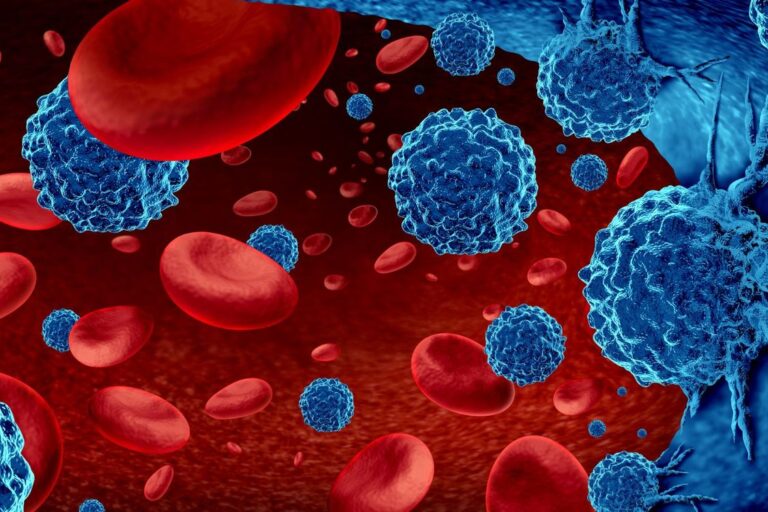Tout laisser tomber (ou être forcé de le faire) pour se focaliser sur la COVID-19 et ses effets. En ce jour anniversaire des cinq ans de la pandémie, des chercheurs, dont Caroline Quach-Thanh et Andrés Finzi, reviennent sur les conséquences – positives ou non – de la crise sur leurs projets de recherche.
Un catalyseur de nouvelles collaborations
La professeure du Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l’UdeM Caroline Quach-Thanh est formelle : «La pandémie aura surtout été le catalyseur de nouvelles collaborations, plus particulièrement avec les immunologues», confie-t-elle.
Comme pour la grande majorité des scientifiques, ses recherches ont été interrompues ou réorientées durant la crise. Certaines de ses études internationales, pour lesquelles elle venait d’obtenir du financement, ont été mises en pause ou interrompues, puisque les collaborations à l’étranger étaient difficiles en raison des voyages suspendus. «Je venais d’obtenir deux financements: le premier pour une étude sur l’épidémiologie des infections invasives à pneumocoque avec le Maroc et le Sénégal et un autre pour une étude avec la Belgique sur la prévention des infections nosocomiales», raconte-t-elle.
Malgré tout, son expertise sur les infections évitables par la vaccination et sur la prévention des infections nosocomiales a été rapidement mise à profit dans des projets sur la COVID-19. Les connaissances acquises dans ces deux années de crise sanitaire serviront également à se préparer à la prochaine pandémie. «La pandémie nous a permis de mettre en place une plateforme de recherche qui profite maintenant à la recherche pédiatrique, plus particulièrement à la préparation pandémique – la plateforme POPCORN que je dirige et qui a été financée par les IRSC [Instituts de recherche en santé du Canada], puis par le Fonds de recherche biomédicale du Canada», ajoute-t-elle.
S’adapter pour la COVID-19 et pour les autres virus
Spécialiste du VIH/sida, le virologiste Andrés Finzi a basculé naturellement vers ce nouveau virus au printemps 2020: le SRAS-CoV-2. Mais ses travaux antérieurs ont été grandement utiles dans la recherche sur ce coronavirus et la course vers le vaccin et les réponses immunitaires à celui-ci. «Nous travaillions sur la glycoprotéine, qui est la clé d’entrée du VIH dans la cellule. Nous avons donc commencé à étudier le SRAS-CoV-2. Même si leurs clés sont différentes, le changement n’était pas trop compliqué», indique-t-il.
Andrés Finzi et ses collègues ont ainsi énormément contribué à la recherche sur la COVID-19: efficacité des vaccins et de certains traitements comme celui à l’aide de plasma de personnes convalescentes, immunité hybride, (re)découverte d’une molécule pour combattre le virus. «L’une des expertises de mon laboratoire, c’est notre travail sur la capacité des anticorps à reconnaître la clé d’entrée du virus et à appeler à l’aide d’autres cellules du système immunitaire pour éliminer les cellules infectées», précise-t-il.
Loin d’être une parenthèse, les travaux menés durant la pandémie ont fait avancer les connaissances qui pourront à leur tour servir dans la recherche sur le VIH, mais aussi sur d’autres virus, estime Andrés Finzi. «C’est sûr qu’on aurait préféré éviter le stress associé!» remarque-t-il. Mais les outils adaptés pour le SRAS-CoV-2 le sont à nouveau pour étudier la grippe aviaire. «On travaille sur ce qui pourrait être la prochaine pandémie. On ne veut pas revivre ce qui est arrivé il y a cinq ans, ç’a été brutal», dit-il.