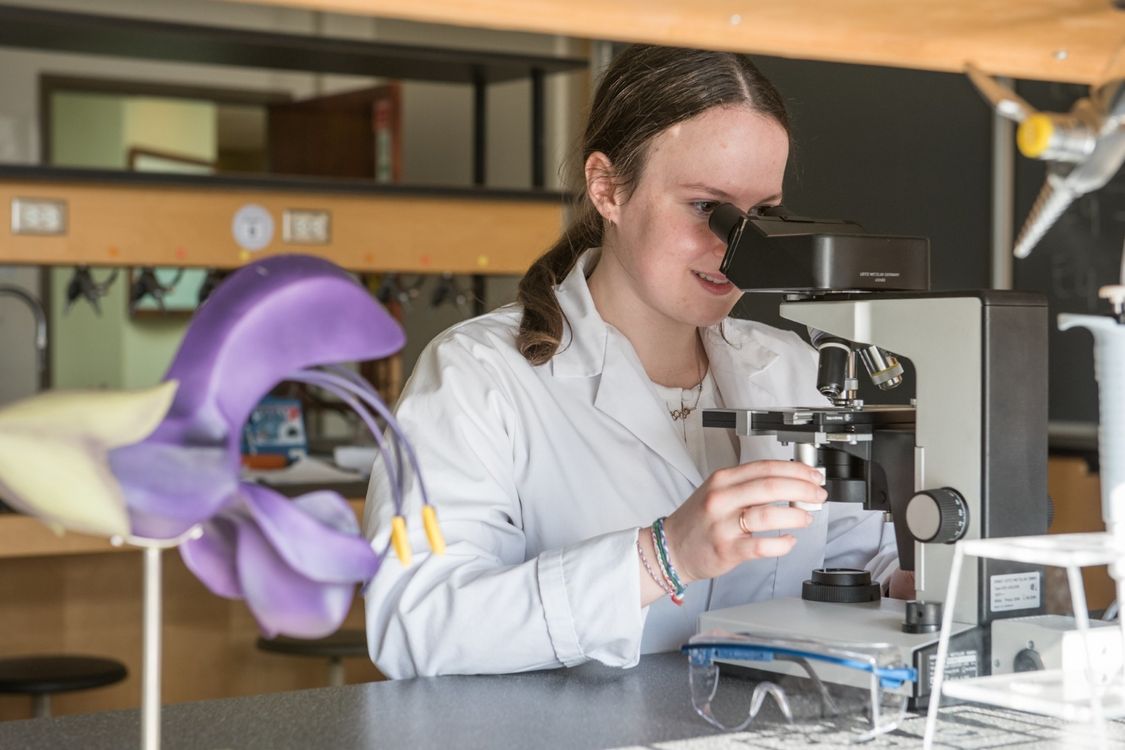À l’UdeM, la valorisation de la recherche va au-delà du transfert technologique: elle touche aussi les politiques publiques, l’innovation sociale et la formation.
«La valorisation de la recherche est souvent définie comme la commercialisation – ce qui est très important –, mais c’est beaucoup plus que ça», précise d’emblée Vincent Poitout, professeur titulaire au Département de médecine de l’Université de Montréal. Avec son arrivée en poste comme vice-recteur à la recherche et à l’innovation en juin, une réflexion s’est amorcée pour élargir la vision de la valorisation à l’UdeM. «Je vois les choses de manière très large: valoriser, c’est donner de la valeur aux découvertes scientifiques. C’est tout ce qui favorise par les parties prenantes l’accessibilité des résultats de recherche et leur utilisation», résume-t-il.
Du transfert de technologie à la création de jeunes pousses en passant par la contribution aux politiques publiques et aux innovations sociales, la valorisation de la recherche peut prendre plusieurs formes et touche toutes les disciplines. La valorisation de la recherche universitaire désigne ainsi «l’ensemble des processus visant à transformer ses résultats en applications économiques, technologiques, sociales ou culturelles. Elle permet de maximiser la portée des avancées scientifiques en les rendant accessibles et utiles à la société», selon la définition adoptée par le Vice-rectorat à la recherche et à l’innovation.